Un français malmené
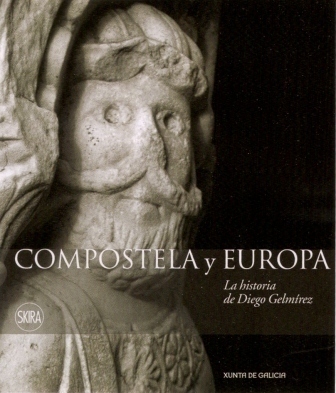
Un catalogue qui malmène la langue française
Or, dès la première page, le lecteur rencontre par deux fois: « l'évêque de Le Puy » au mépris de la règle de contraction habituelle de l'article défini. Plus bas, ce sont : « les Anglais et les Grecs aux leurs chants caractéristiques » qui sont en mal de préposition ; puis p. 102, « le propre Diego Gelmirez » et p. 106 « le propre Suger de Saint-Denis », alors qu'il s'agit de Gelmirez et Suger eux-mêmes, enfin p. 105 le « troisième livre du dénommé Codex Calixtinus » qui n'est pas le nom propre d'une personne que l'on attendrait. Un sort peu enviable est réservé aux titres latins que l'auteure reproduit fautivement parce que, faute de connaître cette langue, elle ne sait manifestement pas ce qu'ils désignent : le « Pénitentiel dit Cordubense » qui n'est autre que le texte appelé communément Pénitentiel de Cordoue. On rencontre, p. 103 à quelques lignes d'intervalle, le Beatus et le Beato, évidemment un seul et même texte, le Commentaire de l'Apocalypse de Beatus de Liebana. La p. 106 nous gratifie de « l'Historia dite Silense », qui n'est pas autre chose que ce qui s'appelle normalement la Chronique du moine de Silos. A la page 108 apparaissent deux variantes intéressantes de ce type d'ignorance : le prétendu titre espagnol " Decreto de Graciano ", alors qu'il s'agit à l'évidence du Décret de Gratien, et « un Priscianus menor » qui mélange allègrement le latin et l'espagnol pour désigner un abrégé de la grammaire latine de Priscien. Il s'agit là d'œuvres qui font partie de la culture de base du médiéviste, mais dont l'auteure ne connaît même pas le titre dans sa propre langue. Comment éprouverait-elle alors la nécessité d'exposer en quelques mots aux non-spécialistes ce dont il s'agit tout en montrant aux spécialistes qu'elle connaît effectivement ce dont elle parle ? Une particularité linguistique originale de cette rédaction est la présence simultanée de formules entre lesquelles il eût normalement été bon de choisir. Ainsi p. 100 « Godescalc, qui en grande compagnie effectua un pèlerinage pendant l'hiver de 950-951 avec un grand cortège » ; p. 104 « il n'est pas surprenant alors que le premier document...soit effectivement un don d'Alphonse II à l'apôtre, dans lequel est cité l'évêque Théodomire est nommé » ; p. 108 « les relations furent également été étroites » ; à la même p. 108, « entreprise qui semble avoir duré environ vingt ans et ne pas avoir été achevée, vu que de nouvelles pièces ayant été incorporées au volume jusqu'en 1180 ». Sans doute certaines de ces fautes sont-elles imputables aux typographes, mais elles n'en donnent pas moins l'impression qu'ici comme ailleurs toutes les vérifications de conformité n'ont pas été faites avec un soin suffisant.
Les pièges de la traduction
Un exemple marquant du parler espagnol en français qui aboutit à une absurdité est fourni par la présentation des Poitevins empruntée au Guide du Pèlerinage. Une traduction française récente (Tallandier, 2003) propose :
« Les Poitevins sont des gens vigoureux et de bons guerriers, habiles à manier les arcs, les flèches et les lances au combat, sûrs dans les affrontements, très rapides à la course, joliment vêtus, le visage ouvert, ils n'ont pas la langue dans la poche, mais le cœur sur la main et la table ouverte ». On préfère ici, p. 105-106,
« Ceux du Poitou sont des gens forts et guerriers, très habiles dans la guerre avec des arcs, des flèches et des lances, audacieux dans la bataille, très rapides aux courses, soignés dans leurs habits, distingués dans leurs factions, rusés dans leurs mots, très généreux dans leurs faveurs, prodigues avec leurs hôtes ».
Ce texte prétendument français suit mot à mot la traduction espagnole du Codex Calixtinus, puisque « distingués dans leurs factions » n'est qu'un calque aberrant de « distinguidos en sus facciones » (p. 514) alors qu'en 1938, Jeanne Vielliard proposait ici : « beaux de visage », pour traduire « in facie praeclari ». Ainsi le détour superflu par la traduction espagnole a-t-il fait que la « face » désignée par l'original latin est devenue ici la « faction ».
Quelques lignes plus bas, on est ravi d'apprendre, d'après la même source, que « les viandes de vache et de cochon de toute l'Espagne et en Galice rendent malades les barbares », phrase qui signifie évidemment que les étrangers (dans le texte espagnol : extranjeros) supportent mal la viande de bœuf et de porc originaire de ces pays. Une telle traduction ne rejoint pas seulement les « belles infidèles » du temps jadis, moins la beauté ; en introduisant ici justement la « vache » espagnole, elle suggère inexorablement la vieille expression populaire française qui discrimine la francophonie des ruminantes ibériques.
A la page suivante (p.107), on peut lire : « le chapitre huitième du livre V du Codex offre une description détaillée du zodiaque de l'arche des reliques de saint Gilles ». Le mot « arche » est un calque de la traduction espagnole (p. 528) qui appelle ig[ [arca]i ]g ce qui est, comme tous les autres traducteurs l'ont bien vu, une « châsse », au demeurant fort célèbre. Mais arca, en espagnol, s'applique aussi à Noé. L'on n'est donc pas surpris de trouver en référence érudite à cette fausse traduction, non la p. 528 où figure, dans la traduction espagnole du Codex Calixtinus, le passage relatif à Saint-Gilles, mais la page 242, où il est question de l'arche de Noé, ce qui est un indice probant de la confusion. L'occasion était bonne de se laisser piéger par un faux ami, quand on croit que la traduction consiste à trouver des équivalents aux mots et non à restituer un sens satisfaisant.
« Les Poitevins sont des gens vigoureux et de bons guerriers, habiles à manier les arcs, les flèches et les lances au combat, sûrs dans les affrontements, très rapides à la course, joliment vêtus, le visage ouvert, ils n'ont pas la langue dans la poche, mais le cœur sur la main et la table ouverte ». On préfère ici, p. 105-106,
« Ceux du Poitou sont des gens forts et guerriers, très habiles dans la guerre avec des arcs, des flèches et des lances, audacieux dans la bataille, très rapides aux courses, soignés dans leurs habits, distingués dans leurs factions, rusés dans leurs mots, très généreux dans leurs faveurs, prodigues avec leurs hôtes ».
Ce texte prétendument français suit mot à mot la traduction espagnole du Codex Calixtinus, puisque « distingués dans leurs factions » n'est qu'un calque aberrant de « distinguidos en sus facciones » (p. 514) alors qu'en 1938, Jeanne Vielliard proposait ici : « beaux de visage », pour traduire « in facie praeclari ». Ainsi le détour superflu par la traduction espagnole a-t-il fait que la « face » désignée par l'original latin est devenue ici la « faction ».
Quelques lignes plus bas, on est ravi d'apprendre, d'après la même source, que « les viandes de vache et de cochon de toute l'Espagne et en Galice rendent malades les barbares », phrase qui signifie évidemment que les étrangers (dans le texte espagnol : extranjeros) supportent mal la viande de bœuf et de porc originaire de ces pays. Une telle traduction ne rejoint pas seulement les « belles infidèles » du temps jadis, moins la beauté ; en introduisant ici justement la « vache » espagnole, elle suggère inexorablement la vieille expression populaire française qui discrimine la francophonie des ruminantes ibériques.
A la page suivante (p.107), on peut lire : « le chapitre huitième du livre V du Codex offre une description détaillée du zodiaque de l'arche des reliques de saint Gilles ». Le mot « arche » est un calque de la traduction espagnole (p. 528) qui appelle ig[ [arca]i ]g ce qui est, comme tous les autres traducteurs l'ont bien vu, une « châsse », au demeurant fort célèbre. Mais arca, en espagnol, s'applique aussi à Noé. L'on n'est donc pas surpris de trouver en référence érudite à cette fausse traduction, non la p. 528 où figure, dans la traduction espagnole du Codex Calixtinus, le passage relatif à Saint-Gilles, mais la page 242, où il est question de l'arche de Noé, ce qui est un indice probant de la confusion. L'occasion était bonne de se laisser piéger par un faux ami, quand on croit que la traduction consiste à trouver des équivalents aux mots et non à restituer un sens satisfaisant.
L'épistémologie en berne
On n'est pas peu surpris, à première lecture, de rencontrer (p. 104) « des personnages ou des thèmes aussi peu hispaniques que l'empereur des Francs Charlemagne et son neveu Roland ». Cette assertion est heureusement contredite (p. 106) par « l'histoire de Charlemagne se rendant à Saragosse et la mort de Roland à Roncevaux » qui réintroduisent le théâtre incontestablement espagnol de leurs exploits légendaires. Au même endroit on peut lire que : « la renommée de l'empereur Charlemagne a dû donc arriver en Espagne de la bouche des pèlerins et a parcouru le Chemin Français », comme si le récit de l'embuscade pyrénéenne ne figurait pas déjà chez un Éginhard que l'on peut supposer connu en Galice avant l'arrivée des pèlerins. Cette « bouche des pèlerins » sert à dissimuler que l'archevêché de Compostelle a vraisemblablement joué un rôle non négligeable dans la genèse de l'affabulation rolandienne intéressée qui présente, sous la plume de l'archevêque Turpin, la conquête de l'Espagne par Charlemagne à l'appel de saint Jacques et le long du « chemin français ». Au demeurant, prétendre (p. 105) que le Guide incite à « la visite des lieux ou s'étaient produits les miracles narrés dans le second livre du Codex », repose sur une confusion, car ce texte invite seulement à visiter les sépultures des prétendues victimes de Roncevaux.
Une thèse non étayée
Ces inexactitudes sont cependant négligeables au regard d'une difficulté de méthode qui obère l'ensemble de cette contribution. Comme l'indique son titre, elle est étroitement tributaire de la thèse même qui sous-tend le projet de l'exposition et de l'ouvrage, à savoir que Compostelle est un « centre », non seulement un centre religieux de dévotion à l'apôtre, mais un centre laïque de rayonnement artistique et intellectuel. Cette thèse paradoxale serait intéressante si elle était argumentée. Mais l'article montre seulement que Compostelle n'était pas un désert culturel, ce que personne n'a jamais prétendu.
Il ne montre pas que le niveau culturel de la ville dépasse une certaine honnête médiocrité, celle que l'on peut attendre d'une cité tout récemment promue siège d'un archevêché. Il n'est pas établi, ce qui est dans la nature même de tout centre digne de ce nom et que l'on peut assez bien suivre pour les institutions considérées à juste titre comme telles, que des intellectuels célèbres ont quitté d'autres établissements européens prestigieux pour venir enseigner à Compostelle ni que des établissements européens en renom ont cherché à attirer chez eux des maîtres formés à l'école de Compostelle.
Aussi la thèse du rayonnement culturel de Compostelle apparaît-elle plus que sujette à caution et sa qualité de « centre » susceptible d'être versée jusqu'à nouvel ordre au rang des vues de l'esprit. Ce n'est pas en évoquant les deux textes connus aujourd'hui et oubliés pendant des siècles que sont l'Historia Compostellana et le Codex Calixtinus que l'on peut faire illusion.
L'Historia Compostellana, écrite pour la plus grande part par deux Français, Géraud de Beauvais, qui fut sans doute le responsable de l'école épiscopale et Hugues, archidiacre de la cathédrale et futur évêque de Porto, n'a connu que des copies espagnoles et, comme la plupart des chroniques locales, n'a eu aucun rayonnement.
La situation du Codex Calixtinus est très différente, si ce n'est exactement l'inverse. Son colophon le déclare écrit nommément sur un axe Rome, Jérusalem, Cluny en évoquant les divers pays d'où il vient : la Gaule, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas (la Frise). Pas la moindre mention dans ce propos de Compostelle ou de la Galice qui autorise à le déclarer rédigé ou même seulement copié dans la capitale galicienne. Si, comme ici, l'on prétend le contraire, il faudrait évidemment expliquer aussi pourquoi les Galiciens de jadis ont été à ce point oublieux de soi qu'ils n'en ont pas revendiqué la paternité et n'en ont tiré aucune fierté, puisqu'ils n'ont même pas cherché à le faire connaître lorsque l'imprimerie en aurait permis la diffusion. L'attribution du Codex Calixtinus à Compostelle ajoute simplement une imposture scientifique de notre temps à cette supercherie religieuse du XIIe siècle.
Il ne montre pas que le niveau culturel de la ville dépasse une certaine honnête médiocrité, celle que l'on peut attendre d'une cité tout récemment promue siège d'un archevêché. Il n'est pas établi, ce qui est dans la nature même de tout centre digne de ce nom et que l'on peut assez bien suivre pour les institutions considérées à juste titre comme telles, que des intellectuels célèbres ont quitté d'autres établissements européens prestigieux pour venir enseigner à Compostelle ni que des établissements européens en renom ont cherché à attirer chez eux des maîtres formés à l'école de Compostelle.
Aussi la thèse du rayonnement culturel de Compostelle apparaît-elle plus que sujette à caution et sa qualité de « centre » susceptible d'être versée jusqu'à nouvel ordre au rang des vues de l'esprit. Ce n'est pas en évoquant les deux textes connus aujourd'hui et oubliés pendant des siècles que sont l'Historia Compostellana et le Codex Calixtinus que l'on peut faire illusion.
L'Historia Compostellana, écrite pour la plus grande part par deux Français, Géraud de Beauvais, qui fut sans doute le responsable de l'école épiscopale et Hugues, archidiacre de la cathédrale et futur évêque de Porto, n'a connu que des copies espagnoles et, comme la plupart des chroniques locales, n'a eu aucun rayonnement.
La situation du Codex Calixtinus est très différente, si ce n'est exactement l'inverse. Son colophon le déclare écrit nommément sur un axe Rome, Jérusalem, Cluny en évoquant les divers pays d'où il vient : la Gaule, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas (la Frise). Pas la moindre mention dans ce propos de Compostelle ou de la Galice qui autorise à le déclarer rédigé ou même seulement copié dans la capitale galicienne. Si, comme ici, l'on prétend le contraire, il faudrait évidemment expliquer aussi pourquoi les Galiciens de jadis ont été à ce point oublieux de soi qu'ils n'en ont pas revendiqué la paternité et n'en ont tiré aucune fierté, puisqu'ils n'ont même pas cherché à le faire connaître lorsque l'imprimerie en aurait permis la diffusion. L'attribution du Codex Calixtinus à Compostelle ajoute simplement une imposture scientifique de notre temps à cette supercherie religieuse du XIIe siècle.
Un discours de propagande culturelle
L'article ne vise qu'à collecter, dans la seule bibliographie espagnole ou presque, les assertions propres à défendre une thèse préconçue. Dans la ligne exacte des instances politique et administratives qui préfacent le volume, il s'agit toujours d'imputer, à la ville de Compostelle une valeur centrale qui est un déni de sa situation périphérique, tant géographique que culturelle. Ce prétendu centralisme compostellan purement idéologique sert de prétexte à un discours claironnant de propagande culturelle. Pour faire bonne mesure, on lui a ajouté en 2010 un culte de la personnalité au profit du premier archevêque, alors que, curieusement, seule une portion congrue a été réservée aux instances religieuses dans cette pompeuse célébration. Bonne occasion pour les scientifiques de montrer, non seulement dans cette contribution hispano-française, que la « trahison des clercs » n'a pas perdu de son actualité.

